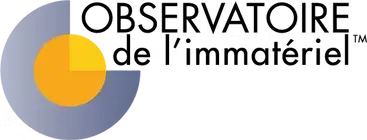Le 1er décembre 2022, la 11e Journée Nationale des Actifs Immatériels (JNAI), organisée par Bpifrance, a réuni des penseurs, des innovateurs et des professionnels pour explorer le potentiel transformateur des actifs immatériels. Dans son discours d’ouverture, Jérôme Julia, président de l’Observatoire de l’Immatériel, a présenté un plaidoyer convaincant pour l’utilisation des actifs immatériels afin de relever les défis complexes des transitions auxquelles notre société est confrontée. S’inspirant du peintre Pierre Soulages, qui affirmait : « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche », Julia a décrit les actifs immatériels comme une démarche à la fois exploratoire et pratique, capable de guider nos sociétés à travers les bouleversements environnementaux, énergétiques, sociaux et économiques.
Les actifs immatériels : une réponse aux transitions
Dans un monde marqué par des progrès fulgurants mais aussi par des régressions, des incertitudes et des conflits, Julia a souligné que notre génération est témoin de transformations profondes. Les avancées en matière d’éducation, de santé et de niveau de vie côtoient des reculs démocratiques, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l’inflation, les inégalités croissantes et les tensions communautaires. Face à ces défis, les actifs immatériels – savoir-faire, capital relationnel, culture organisationnelle, innovation – offrent une solution pour concilier justice sociale, équité et préservation du bien commun, tout en évitant la radicalisation des discours et des oppositions.
Le thème de cette 11e JNAI, « l’Immatériel pour réussir les transitions », met en lumière la capacité des actifs immatériels à redéfinir notre manière de mesurer, de produire et de consommer. Julia a proposé plusieurs illustrations concrètes de leur impact :
- Mesurer autrement : Les actifs immatériels permettent une évaluation plus nuancée, évitant la « quantiphobie » tout en reconnaissant la singularité de chaque individu et organisation. Mesurer l’immatériel, c’est clarifier pourquoi, pour qui et dans quel contexte on mesure, en évitant les comparaisons réductrices.
- Résoudre l’énigme de la productivité : En paraphrasant le paradoxe de Solow, Julia a noté que « l’immatériel est partout, sauf dans les statistiques ». Le travail, orienté vers un objectif, génère des actifs immatériels comme le savoir-faire ou le capital organisationnel. Rééquilibrer les revenus du travail et du capital est une cause majeure pour ce siècle.
- Consommer de manière responsable : Une consommation responsable repose sur des biens et services immatériels, qui « ne s’usent que lorsqu’on ne s’en sert pas ». Cela implique de prêter attention au « mana », l’esprit des objets, pour consommer moins tout en valorisant ce qui est culturel et singulier.
- Redéfinir la richesse : Les actifs immatériels permettent de dépasser la notion restrictive de PIB en prenant en compte les externalités positives des activités humaines, offrant ainsi une vision élargie de la création de valeur.
- Redonner du sens : L’immatériel aide à reconnecter les individus et les organisations à des valeurs fondamentales, en valorisant les externalités positives face à une écologie culpabilisante.
- Responsabilité et héritage : Investir dans l’immatériel, c’est préserver la singularité des organisations, bâtir sur les liens entre actifs et anticiper les évolutions futures. C’est une démarche qui porte à la fois l’héritage du passé et le potentiel de l’avenir.
Pourquoi l’immatériel tarde-t-il à s’imposer ?
Malgré ses nombreuses vertus, l’immatériel peine à s’imposer comme un levier majeur. Julia a identifié plusieurs freins à son adoption :
- Manque d’imagination et peur du changement : La crainte de perdre pouvoir ou richesse freine l’adoption de nouvelles approches basées sur l’immatériel.
- Résistance au changement des rapports de force : Comme l’illustre le roman Applaudissez-moi ! de Philippe Zaouati, certains acteurs maintiennent l’illusion du changement sans modifier profondément les structures de pouvoir.
- Simplification excessive : Selon Esther Duflo, Prix Nobel d’économie 2019, les économistes et décideurs privilégient les grandes réformes au détriment des détails et de l’expérimentation concrète, ce qu’elle appelle le « froid calcul ».
- Manque de temps et aversion à la complexité : Dans une société d’hyper-communication, l’immatériel souffre d’un manque de visibilité et d’une difficulté à être classé dans des catégories simples.
Un appel à l’action : conscience, cohérence, confiance
Pour surmonter ces obstacles, Julia a appelé à un changement de paradigme basé sur la conscience, la cohérence et la confiance. Il a insisté sur l’importance de l’authenticité – gérer son capital émotionnel, assumer ses faiblesses et préserver sa singularité – pour « changer de logiciel » et aborder les transitions avec optimisme.
En conclusion, la 11e JNAI a marqué une étape importante dans la reconnaissance des actifs immatériels comme moteur de transformation. Comme l’a souligné Jérôme Julia, l’immatériel est une clé pour croître autrement, redonner du sens et bâtir un avenir durable. En valorisant ce qui rend chaque individu et chaque organisation unique, nous pouvons relever les défis d’aujourd’hui tout en préparant ceux de demain.